Les troubles de la Personne : la paranoïa P51
Marguerite Pantaine est passée à la postérité sous le nom d’Aimée par l’entremise de Jacques Lacan. Pour sa thèse de doctorat De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, l’impétrant n’a pas fait ce choix par hasard ni complète dérision puisqu’il s’agit du prénom de l’un des personnages d’un roman, « Le détracteur », que sa patiente a écrit et qui figure parmi les textes qu’elle a confiés au psychiatre. Marguerite-Aimée est un cas de rêve pour un clinicien : elle cumule tous les symptômes de la paranoïa dans une existence modelée par la maladie.
Née en 1893 dans une famille catholique et paysanne de l’Île-de-France et élevée par une mère en but à des persécutions imaginaires de la part de ses voisins, Marguerite a, selon les observations de Lacan, commencé à éprouver elle-même des délires de persécution vers 28 ans.

Le premier accès a lieu alors qu’elle est enceinte d’un premier enfant. Elle pense qu’on veut faire du mal au bébé qu’elle porte et développe des comportements agressifs pour le défendre. L’enfant est mort-né et Marguerite se convainc que l’une de ses amies l’a tué, simplement à la suite d’un coup de téléphone qui lui parait suspect. Elle connait ensuite une période plus apaisée mais, lors de sa deuxième grossesse le sentiment de persécution l’envahit à nouveau. Sa grossesse arrive néanmoins à terme mais pendant les cinq premiers mois de la vie de son fils, elle se montre extrêmement protectrice, s’inquiète pour la sécurité de l’enfant et refuse de déléguer les soins maternels à qui que ce soit d’autre alors même qu’elle est mariée. Elle l’allaite jusqu’à l’âge de 14 mois et cherche querelle au moindre soupçon de menace pour son fils. Elle menace de porter plainte contre des voitures qui passeraient trop près de lui. Pourtant Marguerite ne pourra pas assumer longtemps sa fonction de mère.
La jeune femme pense que « les personnes qu’elle croise dans la rue, lui adressent des injures grossières, l’accusent de vices extraordinaires, même si ces personnes ne la connaissent pas ; les gens de son entourage disent d’elle tout le mal possible, et toute la ville de Melun est au courant de sa conduite que l’on considère comme dépravée ; aussi a-t-elle voulu quitter la ville, même sans argent, pour aller n’importe où.» (Lacan) Son délire de persécution s’intensifie jusqu’à justifier un internement dans un hôpital psychiatrique : elle répond en effet à cette soi-disant malveillance par des actes agressifs (crevaison de pneu, jet d’objets), notamment contre son mari. A sa sortie, elle part vivre seule à Paris où elle a des projets d’envergure, notamment en littérature. Elle a par ailleurs déjà fait des démarches pour émigrer aux États-Unis, pays où l’ascension sociale lui parait sans doute plus possible. A Paris, elle est persuadée qu’une actrice, vedette très populaire du cinéma muet, Huguette Duflos, veut faire du mal à son fils qu’elle a pourtant laisser derrière elle. Elle écrit des articles incendiaires contre d’autres femmes célèbres, adorées du public, parvenues socialement et qui vivent dans le luxe: la comédienne Sarah Bernhardt ou l’écrivain Colette par exemple. Des procès d’intention étranges puisqu’elle-même estime avoir droit à ce type d’existence.

Elle écrit donc des lettres au Prince de Galles dont elle se croit aimée et dont elle collectionne les coupures de presse, pour lui faire part de ses soupçons sur Huguette Duflos : celui-ci est de surcroit le dédicataire de deux romans que Marguerite a écrit et le destinataire de nombreux poèmes qu’elle lui aurait fait parvenir et aussi d’une requête pour qu’il prononce un discours à Genève en faveur des enfants. Elle continue à rendre visite à son fils confié à sa famille sans pour autant assumer son éducation. Avant de commettre le crime qui l’enverra en prison, elle sera même omniprésente devant l’imminence d’un attentat contre lui, au point que sa famille lui demandera de lâcher prise.
Marguerite est également persuadée que la comédienne est intervenue pour que ses romans ne soient pas publiés. Bien évidemment, l’aristo anglais ne répond pas à ses sollicitations. Elle harcèle un journaliste pour qu’il publie les articles écrits contre Colette. Des lettres pleines d’outrances ont été envoyées à la maison d’édition qui a refusé son manuscrit. Marguerite est connue des services de police et a même été condamnée à verser une somme d’argent à une employée de ma maison d’édition qui refuse de l’éditer. Bref elle en veut à la terre entière de ne pas reconnaitre son talent et se montre revendicatrice à tout va. On retrouve là ce qu’on appelle un peu pompeusement (mais Dieu que j’aime c’te formule!) la quérulence processive, c’est à dire le penchant excessif à poursuivre en justice.
Petite pause dans le récit : en bonne érotomane, Marguerite se croit aimée d’un homme d’un rang social nettement supérieur au sien puisqu’elle n’est qu’employée dans une administration de chemin de fer et épouse d’un de ses collègues, contre lequel elle a lancé un broc plein d’eau et un fer à repasser, puis qu’elle a laissé en province alors qu’elle s’est établie dans la capitale. A noter que dans les années 20, Edward avait une réputation de tombeur de femmes mariées et volontiers plus âgées que lui, ce dont Marguerite est vraisemblablement au courant. Dans l’esprit de la romancière qu’elle espère devenir, la non-reconnaissance de son talent par la publication ne peut qu’être le résultat d’une intervention malveillante. Mais pourquoi Huguette Duflos? Est-ce uniquement parce qu’elle la considère comme une « putain », une dépravée et une corrompue? Est-ce parce qu’elle a joué dans « Le Chevalier à la Rose » en 1925 et que Marguerite, de métonymie en élucubration, l’aurait associée aux conquêtes d’Edward, prince d’Angleterre dont le symbole est la rose ? La jalousie de Marguerite se serait de toutes façons portée sur une rivale bien sûr fantasmée mais plausible : le délire de Marguerite reste dans les limites du vraisemblable, sur cet aspect en tous cas.

Toujours est-il que le 18 avril 1931, Marguerite passe à l’acte et agresse l’actrice en plein théâtre avec un couteau mais Huguette Duflos esquive le coup. L’assaillante tient des propos incohérents et maintient ses accusations contre la victime devant le commissaire. Elle justifie son acte en disant qu’elle se devait de montrer à la victime qu’elle n’allait pas lui laisser croire qu’elle n’allait rien faire contre les menaces que l’actrice fait peser sur son fils : c’est presqu’un crime d’orgueil donc, plus pour montrer qu’elle ne va pas rester sans réagir plutôt que pour vraiment se débarrasser de celle qui représente le danger.
Cette fois, Marguerite est envoyée en prison, puis à l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne où elle est traitée par Jacques Lacan pendant un an et demi.
Ses symptômes paranoïaques disparaissent une vingtaine de jours après son entrée en prison : elle reconnait par lettre que l’actrice n’est pour rien dans cette affaire mais aussi que ses ambitions littéraires sont bien au-dessus de ses moyens réels. Cette prise de conscience de la vanité de sa mégalomanie (ses aspirations n’atteignent néanmoins pas la taille des délires paraphréniques) pousse Lacan à déterminer qu’elle souffre d’une « paranoïa d’auto-punition ». En d’autres termes, le fait d’être punie la tranquilliserait. Elle souffrirait d’une culpabilité inconsciente et puisqu’elle l’aurait évacuée à travers une peine de prison, le délire serait alors devenu obsolète. La culpabilité naissant du sentiment de ne pas avoir « payé le prix », le fait d’être condamnée et de purger une peine de prison pourrait expliquer la « guérison » de Marguerite. La thèse de Lacan se tient.
Je proposerai pourtant une autre explication légèrement différente et plus conforme à la définition que la théorie de la médiation donne de la paranoïa qu’elle n’assimile nullement à un trouble de la gestion du désir. Marguerite était à la fois en but à des angoisses de persécution et en quête de reconnaissance à travers l’écriture. Elle écrivait des romans que personne ne publiait et a fortiori ne lisait. Lors de son traitement, elle les a remis à Lacan qui les a gardés. Avant même de commencer son traitement, Marguerite pensait que des gens voulaient lui voler ses textes dont peu de gens connaissaient pourtant l’existence. Elle a même accusé l’écrivain Pierre Binot de lui avoir pompé des idées pour écrire ses histoires, dans ses romans inédits et dans sa vie. Elle aurait mieux fait de se méfier de Lacan pour lui ravir la vedette mais lorsqu’elle l’a rencontré et qu’elle a échangé par écrit avec lui, elle avait baissé la garde et ne se défiait probablement plus d’autrui de la même manière. La crainte qu’on attente à la vie de son fils ou qu’on lui vole ses idées témoigne du harcèlement imaginaire dont elle pensait faire l’objet : je l’envisage comme la peur irraisonnée de se voir ravir son statut et la reconnaissance qui va avec, celui de mère d’abord, puis celui de femmes de lettres et d’amoureuse. Ce n’était donc pas de la culpabilité. Bien au contraire, elle payait suffisamment le prix à ses propres yeux et ne manquait pas d’estime de soi. Son ambition était légitime mais sa paranoïa a fait naitre en elle l’idée que son échec social n’était pas mérité parce qu’elle était incapable de savoir jusqu’où elle maitrisait son destin. Privée de #rôleUnité déontologique, synonyme de métier. Pour la théorie de médiation, le rôle est justement la capacité à définir structuralement jusqu'où on est compétent et quand commence le métier de l'autre.... More, elle tente de s’en créer sans jamais vraiment réussir à poser les limites de son pouvoir. D’abord, ultra-possessive avec son enfant, elle ne va ensuite pas pouvoir l’élever. Par un hasard assez extraordinaire, Didier Anzieu, le fils de Marguerite, se retrouvera lui-même sur le divan de Lacan et deviendra psychanalyste. Selon Jean Allouch, la mère de Marguerite aurait souhaité qu’elle soit institutrice. Il souligne également le fait que la mère de Marguerite, délirante elle-même, avait perdu une première petite fille, déjà appelée Marguerite, dans des circonstances atroces. L’égo de Marguerite Pantaine va se construire dans un cadre pour le moins tourmenté avec une mère elle-même incapable de « faire de la place » à sa propre fille.

Marguerite se cherche donc un #ministèreSynonyme de partie, c'est à dire l'unité déontique. More mais en l’absence d’#établissement stable, elle va pousser la Loi (à comprendre ici comme l’usage en vigueur, la limite entre ce qui se fait et ne se fait pas) très loin pour en éprouver la résistance car dans le délire, celle-ci n’advient pas. Dans le délire, Edward est amoureux, Marguerite a du talent, Binot est un usurpateur, Huguette Duflos une intrigante. Comme les lettres au prince de Galles et les tentatives de publication sont restées sans réponse, Marguerite est allée chercher la limite et défendre sa position le couteau à la main pour « tuer » (ou du moins mettre hors d’état de nuire) celle qui lui parait être la source de cette négation de reconnaissance et de cet anonymat prolongé. La violence de l’agression à l’arme blanche est une réponse à la cruauté du sort dont elle se sent victime. Marguerite pêche par excès d’orgueil et se montre incapable de reconnaitre que ses romans ne valent tout simplement pas la peine d’être publiés, que le prince de Galles ne sait même pas qu’elle existe et qu’elle-même est vouée à rester dans l’ombre, contrairement à la star Huguette Duflos qui lui vole la lumière et qu’elle tente d’écarter de son chemin vers la notoriété et l’amour. Il y a une rationalité implacable dans la logique délirante de Marguerite, celle d’une femme bien décidée à se faire une place au soleil, preuve tangible de l’approbation d’autrui. Or c’est la réprobation d’autrui par un jugement pénal qui va lui fixer à nouveau une limite et stabiliser pour un temps cette déontologie meuble qui la faisait délirer : dans un cadre rigide mais stable comme la prison, le délire s’est estompé. Elle y a trouvé la position congrue, aussi improbable que cela puisse paraitre pour une femme qui rêvait de notoriété. Laissée à elle-même, elle envahissait l’espace social et se donnait une importance démesurée. Sous le coup de la Loi retrouvée et sous le joug de l’incarcération, elle retrouve un équilibre et un sens des proportions salvateurs.

Selon Lacan, Marguerite a tout simplement été guérie par sa sévère punition pour sa tentative d’homicide. Il avait raison mais pas pour les bonnes raisons.
On sait par ailleurs que certains de ses délires sont réapparus plus tard : il s’agit de Marguerite, pas de Jacques. Or, ils ne lui ont pas pourri l’existence. Ils ne l’ont pas non plus menée à être de nouveau hospitalisée. La thèse de Lacan a donc été jugée correcte. Je la pense en partie erronée à cause d’un manque de déconstruction. Si la culpabilité peut interférer avec la paranoïa, elle n’est pas, me semble-t-il, directement en cause.
La clinique médiationniste n’a pas à sa disposition suffisamment de rapports construits par des membres qui s’en revendiquent et l’Anthropologie pour les Quiches encore moins. Peu de psychiatres se sont ralliés au modèle que propose Gagnepain et opèrent toujours sur des stéréotypes nosographiques à visée de toutes façons avant tout thérapeutiques : leur mission de médecins est essentiellement de trouver le traitement chimique pour stabiliser les patients et de maintenir un certain ordre dans leurs services. Les psychanalystes, pour la plupart, n’ont pas non plus opéré la distinction des plans sociologiques et axiologiques et continuent à servir un embrouillamini conceptuel en cercles de plus en plus restreints. Les biographies de patient qu’ils proposent présentent toutefois beaucoup d’intérêt pour la théorie, même si pour l’instant nous ne nous sommes pas penchés du tout sur l’origine des troubles ni leur implantation corticale. On fait donc avec ce qu’on a, c’est à dire la plupart du temps les travaux des cliniciens qui ne participent pas au même univers théorique que nous, et je suis par conséquent souvent dans la position d’un détective dans une contre-enquête qui doit glaner les informations collectées par d’autres limiers qui ont construit un dossier « à charge » afin de proposer une version inédite à partir des mêmes éléments mais surtout cohérente avec le cadre que nous impose la théorie.
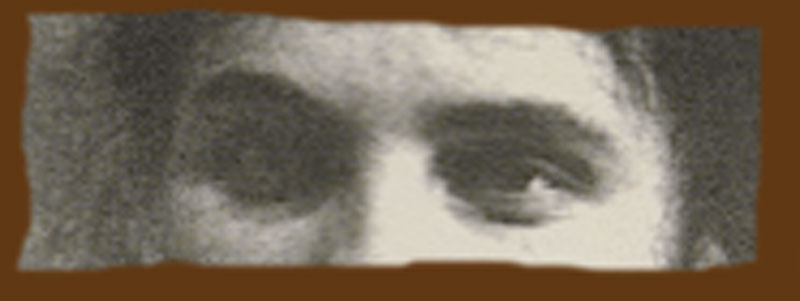
Pour en terminer avec le cas de la mère (diagnostiquée paranoïaque) de Marguerite, disons que Jeanne répandait sur sa fille son propre-mal-être et ses aspirations : elle avait baptisé sa deuxième fille du prénom même de sa première petite morte brûlée vive et voulait que sa fille soit institutrice. Pour s’affranchir de l’ingérence toxique de sa mère sur sa souveraineté, autrement dit pour prendre en main sa destinée personnelle, Marguerite va fuir loin sans pouvoir pour autant échapper à sa propre paranoïa. La première agression contre la reconnaissance à laquelle elle prétend vient donc de sa mère et Marguerite, loin de l’accuser, va chercher un bouc-émissaire extérieur à leur relation : la paranoïaque ne segmente plus les #rôles. La relation mère abusive/fille possédée (ou dépossédée suivant le point de vue qu’on adopte) intoxique le reste des relations sociales de Marguerite qui s’invente une histoire d’amour avec le prince de Galles alors qu’elle est mariée et fait porter à une totale étrangère la responsabilité de son échec littéraire. Elle se comporte par ailleurs elle-même comme une mère « couveuse » avant d’abandonner son enfant qui sera élevé par d’autres membres de sa famille. Dans sa paranoïa, Marguerite oscille entre les extrêmes et, après s’être sentie menacée durant sa grossesse ou en la personne de son enfant qu’elle surprotège, s’invite dans des existences (correspondance, agression ou même création romanesque, rêvant d’avoir un rôle à jouer dans le monde intellectuel) qui ne la concernent pas mais sur lesquelles elle projète son délire tout comme sa mère a projeté sur elle une identité qui, en un sens, n’était pas la sienne mais celle d’une soeur décédée plus tôt. Le problème de Marguerite est donc de ne pas savoir exactement où c’est à elle de faire la Loi. Lorsque que son pouvoir et donc sa sécurité, ses compétences et son talent lui font l’effet d’être mis à mal et niés, elle contre-attaque par des accusations, des lettres d’avertissement, des critiques virulentes, quelques passages à l’acte bénins, puis une tentative d’assassinat. Elle est d’autant plus agressive qu’elle est blessée dans son ego. Mais elle se trompe de cible dans sa défense : difficile en effet pour elle d’en vouloir à sa mère ou même de l’identifier comme la racine de son insécurité chronique et de sa fragilité narcissique.
En donnant la vie, la mère offre l’essentiel de l’être et la reconnaissance du petit est attendue en retour de ce don qu’est la vie. L’enfant ingrat est l’une des douleurs les plus aiguës qui puissent l’atteindre. Or cette ingratitude est nécessaire pour que l’adolescent puisse faire sa vie et accéder à l’âge adulte. Mais une mère insécure aura tendance à vouloir préserver la relation d’abord exclusive pendant la grossesse, puis privilégiée par la suite. Le gendre ou la bru pourront même parfois apparaitre comme des rivaux à jalouser, voire des prédateurs à faire disparaitre, quitte à pratiquer une prévention délirante : l’éventuel conjoint de l’enfant devient alors le danger à prévenir, l’autre à tenir à l’écart. Jeanne voulait que sa fille soit institutrice : elle visait donc pour elle une promotion sociale certes mais également un statut qui l’aurait gardé hors du « mariage émancipateur » puisque de nombreuses institutrices restaient célibataires dans les années 1920-1930. Mais Marguerite est devenue employée et s’est mariée. Elle s’est en quelque sorte émancipée mais sera rattrapée par la maladie et reproduira le processus familial à sa manière.

avant que son fils ne dérape grave…
Autre cas de mère abusive. Nous ne parlerons pas de mère castratrice car je réserve ce terme à la version sadique de la relation mère/enfant. Quant au terme « possessive », il s’applique à des cas comme nous le verrons plus loin, qui ne peuvent pas vraiment être taxés de maladifs. Augusta Wilhelmine Lehrke (1878-1945) serait sans doute restée totalement inconnue si elle n’avait été la mère d’Ed Gein, le boucher de Plainfield, le tueur nécrophile qui inspira le personnage de Norman Bates à Alfred Hitchcock pour Psychose. Cette états-unienne du Wisconsin épouse George Philip Gein (1873-1940), un homme violent et alcoolique qui lui fait deux fils : Henry (1901-1944) et Edward(1906-1984). C’est elle qui les élève et en luthérienne fanatique qui répète que les femmes sont toutes les « récipients du péché » et des créatures immorales, elle s’emploie à décourager tout désir sexuel chez ses fils, de peur qu’ils aillent en enfer. Femme dure et dominatrice, Augusta ne trouve aucune difficulté à imposer ses croyances par la force, tant à ses fils qu’à son mari qui n’a pas son mot à dire dans l’éducation des garçons. En réalité, Augusta méprise profondément son époux, allant jusqu’à prier chaque jour pour que celui-ci meure et demandant même à ses fils de l’accompagner dans ses suppliques. C’est un comportement particulièrement paradoxal chez une chrétienne et encore plus chez une protestante qui n’est pas susceptible de s’adresser à Dieu pour lui demander un intervention contre son mari. On est plutôt dans le domaine du vaudou. A cela s’ajoute la subornation des adolescents qu’elle entraine donc à nuire à leur propre père.
En guise de réponse, George Gein se met à battre sa femme. C’est non seulement simpliste mais inefficace. Augusta méprise tout autant ses fils et les insulte souvent, persuadée qu’ils vont devenir des ratés, « comme leur père ». Elle continue pourtant à les élever avec ses propres convictions en leur lisant la Bible. Durant leur adolescence et le début de l’âge adulte, Augusta prive Henry et Edward de tout contact avec les jeunes de leur âge. Néanmoins, la seule femme à laquelle Ed Gein s’attache est sa mère : le jeune garçon lui voue même un véritable culte, tandis que Henry, plus distant, mène une vie plus normale.
En 1906, l’année même de la naissance d’Edward, sa mère ouvre une épicerie à La Crosse, petite ville du Wisconsin à la frontière du Minnesota. Augusta se montre très en avance pour son époque dans son milieu car le petit commerce permet de faire vivre la famille confortablement. En 1914, les Gein s’installent dans une ferme de près de 80 hectares située à 9 km de Plainfield, une petite bourgade d’environ 640 habitants, au centre du Wisconsin. Grâce à l’argent qu’elle a elle-même gagné, Augusta fait déménager la famille et surtout ses fils dans un coin nettement plus rural et loin de la ville tentatrice et de « toute influence néfaste qui aurait pu corrompre la famille ».

« Massacre à la tronçonneuse »
A 13 ans, Edward est retiré de l’école par sa mère sous prétexte d’avoir besoin de lui pour les travaux de la ferme. Le garçon n’avait, semble-t-il, pas d’amis et sa mère le réprimandait s’il tentait de s’en faire. Une fois Ed extrait de l’école pour vivre à la ferme, l’affaire était entendue sur ce point. Henry était plus critique quant à l’attachement malsain qu’Edward entretenait avec sa mère. Il faisait fréquemment des commentaires désobligeants et Ed en prenait ombrage. George meurt d’une crise cardiaque en 1940. Le 16 mai 1944, Henry trouve la mort dans des circonstances non élucidées, peut-être victime de son frère. Augusta fait alors une série d’attaques qui la laissent paralysée et elle meurt le 19 décembre 1945, laissant Ed anéanti par le chagrin et désemparé devant tout ce qu’il va devoir assumer seul, et notamment sa relation avec les femmes, lacune essentielle dans son éducation. D’une manière générale, je pense que la défiance chronique d’un parent vis à vis de l’institution scolaire (même si je n’en pense pas que du bien, loin de là), et a fortiori la prise en charge totale de son apprentissage est une manifestation d’un trouble de la délégation. Pour que celle-ci puisse opérer, il est impératif que les parties soient clairement définies : si l’instruction (apprentissage des savoirs culturels et techniques) revient aux professionnels, l’éducation (apprentissage du vivre ensemble et du comportement moral) devrait échoir aux parents. C’est schématique et dans la pratique, les #partiesSynonyme de partie, c'est à dire l'unité déontique. More s’enchevêtrent. Avec la paranoïa, le rôle de chacun ne se définit plus et la personnalité paranoïaque aura l’impression qu’on marche sur ses plates-bandes et tendance à empiéter sur celles de l’autre. Pour Augusta, le problème est tranché à son avantage : elle seule décide de l’éducation sociale et morale de ses fils pour répondre aux dangers de l’extérieur. Question instruction, Ed aura bénéficié de l’apprentissage de la lecture, savoir indispensable pour un luthérien. Le reste, il l’apprendra avec sa mère ou par lui-même à la ferme.
Nous retiendrons donc d’Augusta l’injustice dont elle s’estime victime puisqu’elle est elle-même un des « récipients du péché ». Persécutée par le mal qu’elle voit partout et qui se dissimule dans chaque être humain (y compris son mari et ses fils), elle va pourtant vaincre sa misanthropie en gagnant de l’argent : le protestantisme considérait le travail et sa rémunération comme un don de Dieu. Son émancipation et sa revanche sur le Malin passe donc par le labeur et le profit : elle abandonne bientôt le commerce pour l’agriculture, espérant sans doute ainsi augmenter son autonomie tant vivrière que sociale. Pour ce qu’il est advenu de Ed Gein, je vous renvoie en P47. Ajoutons seulement qu’une fois livré à lui-même, l’enfant (tout de même âgé de 39 ans mais immature) à la fois humilié et couvé par la même femme tentera de la maintenir en vie par un bricolage macabre.
Le fait qu’Augusta « écrase » son fils me semble moins important que le fait qu’elle le surprotège contre un univers hostile. La protection paranoïaque l’emporte sur l’apparente domination sadique mais il reste du flou sur cette question. L’abus de pouvoir sadique débouche sur la destruction de la compétence d’autrui et sa castration (suppression de pouvoir) dans un cadre restreint, un ministère bien délimité que le pervers va respecter pour ne pas être contré dans sa domination. L’abus de confiance paranoïaque ne tient pas compte de cette compartimentation : le paranoïaque se manifeste un peu partout. Il ne nie pas la compétence d’autrui. Au contraire, il la stimule même parfois de manière totalement déplacée ou à l’inverse, s’auto-proclame responsable de mission qui n’ont pas de raison de lui incomber. Marguerite en appelle autant à l’intervention d’un prince héritier qu’elle lui impose son amour. Elle se permet de critiquer vertement les moeurs d’une actrice tout en redoutant son pouvoir sur son enfant. En l’absence de frontières bien nettes entre ce qui est du ressort de l’un et ce qui est du devoir de l’autre, le paranoïaque étend abusivement sa responsabilité ou au contraire va demander de l’aide à quelqu’un, qui aura un statut social plus élevé et donc un pouvoir plus important, mais que ça ne regarde absolument pas. D’où le recours à la justice du plaignant maladif qui demande à l’institution légale de régler des conflits qui n’ont pas lieu d’être. Le sadique tendra vers la discrétion qu’offre par exemple le cercle familial ou le couple quand le paranoïaque transformera volontiers son problème en affaire d’état.
Je manque bien évidemment de détails sur Augusta qui contrairement à son fils n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie et dont je n’ai pu dresser qu’un grossier portrait assez proche de ce qu’on avait coutume d’envisager comme une matrone qui porte la culotte. Comme pour Marguerite et Jeanne, une relation équilibrée avec un partenaire ne semble pas envisageable à cause de l’impossibilité de définir les rôles de chaque partie, base d’une relation viable.
Par l’inévitable intimité qu’elle provoque d’abord entre la mère et l’enfant, puis entre le père et l’enfant, la relation parent/enfant offre un milieu (et non un terreau) propice au développement de la paranoïa. Cependant, le modèle nous impose de penser qu’elle ne peut y trouver un espace d’action exclusif. Autrement dit, la paranoïa ayant tendance à déborder de la partie congrue, les symptômes pour peu qu’on sache les déceler sortent inévitablement du cadre d’une relation unique. A mesure de son évolution, la maladie va toucher de plus en plus de sphères de la vie de la personne. A l’opposé du paraphrène, mais aussi du sadique me semble-t-il, le paranoïaque cultive l’appel à témoins et le scandale public.
La relation toxique avec l’enfant ne sera donc pas la seule manifestation du trouble : on l’a vu avec Marguerite et Augusta qui protègent leurs enfants contre une menace externe. Si en apparence, elle peut parfois ressembler à une hyper-protection maladive, la mise sous coupe réglée par la mère castratrice ne me semble pas relever du même trouble. On y reviendra très prochainement avec notamment l’étude de Vipère au poing.
Et c’est de la littérature. A la revoyure!
Pour aller plus loin :
https://www.lexpress.fr/culture/livre/lacan-envers-et-contre-tout_1028227.html
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/20075.pdf
